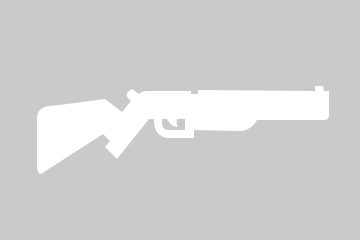Paul Duchein, la passion de la bécasse

Président de l’Association suisse des bécassiers depuis neuf ans, Paul Duchein, installé en Suisse depuis
cinquante ans, s’efforce de défendre la chasse au petit gibier, méconnue et surtout en péril dans notre pays.
Propos recueillis par Vincent Gillioz, photos d’Yvon Crettenand
Paul Duchein, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Volontiers ; je suis d’origine française et je vis à Villars-sur-Glâne. J’ai passé ma jeunesse dans les Pyrénées, et suis arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, pour un stage qui devait durer une année. Je ne suis plus reparti. J’ai aujourd’hui 72 ans. Je suis retraité depuis neuf ans, et j’ai passé ma vie professionnelle dans le monde des installations techniques du bâtiment. J’ai une maîtrise fédérale de projeteur sanitaire, et j’avais un bureau d’études.
Qu’en est-il de votre carrière de chasseur ?
J’ai commencé avec le père d’un ami, qui est en fait mon père spirituel de chasse. Nous allions à la caille des blés, au tétras-lyre en montagne, et aussi à la bécasse. J’ai pris mon premier permis de chasse à 16 ans, comme la loi le permettait. À cette époque, il fallait simplement aller le chercher à la préfecture. Et j’ai chassé dans ma région pendant cinq ans, avant de venir en Suisse.
Une fois installé à Fribourg, je suis retourné chasser chez moi occasionnellement en allant rendre visite à mon père. Mais je n’ai pas passé mon permis suisse tout de suite. Je trouvais que la chasse était beaucoup trop contraignante. Si je prends l’exemple de la trêve du dimanche, c’est quelque chose d’inconcevable en France. Là-bas, on bosse la semaine, et le dimanche, on va chasser, c’est une tradition. Ceci dit, au fil des ans, j’ai compris que le système suisse avait ses avantages. En France, la période autorisée pour chaque gibier est longue, et au final, il y en a peu. Ici elle est bien plus courte, mais on en profite peut-être mieux, et c’est favorable à une bonne gestion. Du coup, j’ai fini par passer mon permis fribourgeois à 33 ans. J’ai énormément appris sur la faune, la flore et la chasse durant les cours.
Vous êtes un bécassier avant tout. Comment expliquez-vous votre passion pour cet oiseau ?
J’ai longtemps chassé le chamois, mais depuis qu’il y a tirage au sort je les laisse aux spécialistes. Les quatre premières semaines, je chasse le chevreuil avec un groupe d’amis et leurs broussailleurs très performants. Mais c’est vrai que la bécasse est ma chasse de prédilection. Adolescent, elle m’a fait ressentir mes premières émotions cynégétiques qui, adulte, se sont transformées en passion. Un ornithologue aura du plaisir à identifier tel ou tel oiseau par son chant, ou à l’observer. Mon plaisir, c’est avant tout d’apprécier le travail du chien, qui sait trouver un oiseau introuvable, qui sait le bloquer. C’est une chasse respectueuse pratiquée avec éthique. Le bécassier ne prélève que si le chien a fait un travail irréprochable. C’est vraiment une chasse passion, une chasse plaisir.

Vous êtes président de l’ASB depuis neuf ans, que pouvez-vous nous dire sur cette association ?
Elle a été fondée en 1999 par Philippe Leresche et un petit groupe de passionnés romands dont Henri-Armand Meister, à la suite d’une assemblée des chasseurs vaudois. Le conservateur de la faune de l’époque avait recommandé aux bécassiers de se fédérer, car il sentait que cette chasse, pratiquée uniquement en Suisse latine, était de plus en plus critiquée, et qu’il fallait la défendre. Philippe Leresche est resté président douze ans, et j’ai repris la main en voici neuf. Je vais arrêter cette année, et céder la présidence à un Tessinois. Il y a deux fois plus de bécassiers au sud des Alpes que dans toute la Romandie et ils ont une grande culture de cette chasse. Nous sommes actuellement un peu plus de deux cents membres, et comptons dans nos rangs en Romandie environ soixante pour cent des chasseurs de bécasse.
Quelles sont vos principales activités ?
En plus de la chasse, les plus cynophiles d’entre nous participent à des concours de chiens d’arrêt en Suisse et en France, mais surtout, nous réalisons un monitoring annuel des bécasses présentes en période de chasse. Nous avons récemment publié notre rapport de vingt ans de suivi de la migration, qui était cité dans vos pages. Nous avons une centaine de bécassiers qui envoient leur feuille de sorties, ça nous permet d’avoir énormément de relevés de terrain, et nous avons une base de données très crédible. Depuis la dernière saison, nous disposons également d’une application de saisie en ligne. Notre étude montre notamment que malgré la diminution de chasseurs de ce gibier, on tire toujours autant de bécasses chaque année. Ça prouve que leur nombre ne diminue pas, et qu’elles se portent plutôt bien.
Nous faisons également partie de la FANBPO (Fédération des associations nationales de bécassiers du paléarctique occidental) qui rassemble les associations du Portugal, d’Espagne, de France, d’Italie, d’Irlande, du Pays de Galles, de Suisse et des correspondants dans d’autres pays. Son but est de maintenir dans un état de conservation favorable les populations de la bécasse des bois, et de préserver ses habitats dans le paléarctique occidental, particulièrement en Europe, tout en permettant une utilisation rationnelle de cette espèce par une chasse durable et contrôlée. Cette fédération coordonne les efforts entrepris individuellement par les membres, grâce à un réseau de collectes de données et d’échanges d’informations.

Il y a également un projet fédéral sur la bécasse ?
Il s’agit en effet du Projet national sur la bécasse des bois. Lors de la révision de l’ordonnance fédérale en 2012, il y a eu des discussions parlementaires animées sur le statut de cet oiseau. Du coup, les autorités ont demandé une étude pour permettre de prendre les bonnes décisions, et déterminer si l’on peut continuer à la chasser durablement.
Ce projet est mené par un groupe scientifique et un groupe stratégique. Il y a dans chaque groupe des gens de terrain, des scientifiques, des bécassiers, des ornithologues ou des biologistes. Les données sont recueillies sur le terrain, le groupe scientifique les soumet au groupe stratégique, qui les discute avec l’OFEV afin qu’il en ressorte un rapport final. Celui-ci est attendu en septembre, mais ce que nous savons déjà, c’est que l’incidence de la chasse suisse sur la population de bécasses des bois indigènes et européennes est marginale.
Les milieux ornithologiques combattent la chasse à la bécasse des bois, pourquoi ?
Le problème, c’est que les ornithologues et la Station de Sempach se réfèrent toujours à la bécasse indigène, celle qu’ils suivent durant la croule en Suisse. Elle est effectivement en diminution, comme dans beaucoup d’autres pays situés en bordure ouest de l’aire de nidification de l’espèce. Cette baisse localisée est due à plusieurs facteurs, comme le réchauffement climatique ou l’évolution du milieu forestier, et l’utilisation toujours plus importante des milieux naturels par l’homme. Du coup, la bécasse remonte nicher vers d’autres territoires mieux adaptés, car les conditions ne lui conviennent plus ici. Mais la bécasse indigène suisse est également migratrice, et elle quitte la Suisse l’automne pour être chassée à l’étranger jusqu’en février !
Ce n’est pas elle que nous rencontrons majoritairement en automne. Ce sont celles qui viennent de l’immense zone de reproduction comprenant la Russie occidentale, les Pays baltes et l’Europe centrale, et qui descendent hiverner sur le littoral atlantique ou méditerranéen. Elles arrivent nombreuses et font halte dès la première décade d’octobre. Mais les ornithologues ne sont plus sur le terrain pendant la chasse. Ils considèrent de toute façon qu’il ne faut pas tirer les oiseaux, et se battent donc pour faire cesser cette chasse, même si elle n’impacte pas l’espèce.

Quels sont selon vous les meilleurs moyens de défendre et soutenir la chasse à la bécasse ?
Cette chasse n’est pas une chasse de régulation, et nous devons d’abord l’assumer. En tant que bécassiers, nous devons faire une espèce de coming out, et être prêts à dire que nous chassons pour le plaisir, pour la tradition, mais de manière durable et surtout éthique. On ne chasse plus à la croule ou à la passée – ce ne serait que du tir – mais sportivement à l’arrêt du chien.
Par ailleurs, je voudrais dire à l’ensemble des chasseurs d’être solidaires avec la minorité des bécassiers (1% du nombre des chasseurs suisses) et de se mobiliser pour ne pas laisser interdire la chasse aux oiseaux.
Je suggère aux bécassiers de prendre des accompagnants, chasseurs ou non, avec eux. On ne fera jamais changer d’avis un anti-chasse. Par contre, si j’invite un sceptique, et qu’il peut observer toute la subtilité de cette chasse, il pourra la comprendre et l’apprécier. C’est une chasse difficile, il faut trois heures pour lever une bécasse, et dix heures pour en prélever une. Cela illustre parfaitement notre esprit : chasser beaucoup pour prélever peu.
Finalement, quels conseils donneriez-vous à un jeune chasseur qui voudrait se lancer dans la bécasse ?
Il faut d’abord accompagner un bécassier. Se trouver un parrain, et aller chasser avec lui un ou deux ans pour se rendre vraiment compte de ce que c’est. Chasser la bécasse, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut comprendre et réaliser l’importance du complice indispensable qu’est le chien. Et il faut être sûr d’être prêt à s’en occuper toute l’année pour quelques semaines de chasse. Il faut l’éduquer, le créancer sur l’oiseau, c’est un travail de plusieurs années avant de disposer d’un bon auxiliaire.
Le critère primordial pour le choisir, c’est la souche. Il doit avoir une ascendance reconnue de chasse ou de travail, le nez est plus important que la race ou la couleur, qui ne sont qu’affinités personnelles. Après avoir eu des épagneuls bretons, je me suis mis aux setters anglais qui m’ont tous apporté beaucoup de satisfactions.